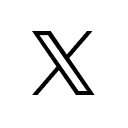Pourquoi vous êtes-vous prise de passion pour l’agriculture, et notamment pour les cultures mal aimées du grand public, comme le maïs et maintenant la betterave ?
Dix-sept ans d’humanitaire, à Médecins sans Frontières d’abord puis Action contre la Faim, m’ont convaincue de la nécessité absolue d’avoir une agriculture performante, nourricière, dynamique, qui rémunère correctement celui qui la met en œuvre tout en rendant la nourriture accessible au consommateur. Ceux qui ont faim dans le monde sont les pauvres, ceux qui n’ont pas de pouvoir d’achat. Le maïs est la première céréale au monde, présente dans plus de 150 pays, à la fois très productive, très adaptable et totalement polyvalente. Mais elle est méconnue et injustement critiquée. Quand j’ai découvert toutes les performances de la betterave à sucre, son incroyable histoire, à la fois géopolitique, semencière, mais aussi la technicité de sa production, je n’ai pu m’empêcher de faire un parallèle entre ces deux plantes alimentaires, aussi indispensables que méconnues.
Un de vos ouvrages a pour titre : « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ». Quel est votre principal argument ?
Le premier des besoins humains est la nourriture (et bien sûr l’eau). Seuls les agriculteurs ont le pouvoir de nous nourrir correctement tout en sublimant la nature. On peut bien sûr imaginer une agriculture sans paysans, mais on se priverait alors des paysages, d’un stockage inégalable de carbone, de toute cette biodiversité nourricière que l’agriculture met en œuvre, du biosourcé qui permet de remplacer le fossile… Bref, quand on travaille avec et au service du vivant, on a le pouvoir de sauver le monde en apportant toutes les réponses aux grands défis du développement durable.
L’arrêt des usines d’engrais azotés pourrait-il conduire à un retour de la famine ?
Bien sûr. La question des fertilisants est stratégique et vitale, surtout quand vous voyez les faibles rendements des agricultures du Sud. La guerre en Ukraine menace l’approvisionnement des pays pauvres. Ce qui m’a marquée avec la betterave sucrière, c’est que, comme le maïs ou le cochon, tout y est bon et utile. Et les pénuries, qu’il s’agisse d’engrais, d’aliments pour animaux ou d’énergie, peuvent être comblées par une utilisation intelligente de tous ses sous-produits, qui ne concurrencent pas en outre la production alimentaire !
Vous parlez de l’éco-anxiété. Mais il ne semble pas y avoir autant d’anxiété sur la disponibilité de l’alimentation. Qu’est-ce que cela dit de notre société ?
Au contraire, je pense qu’il y a aussi une anxiété sur l’alimentation, qui pousse les gens à faire des stocks dès que la menace de pénurie se profile. Regardez ce qui s’est passé pendant le premier confinement dû au Covid ! Pensez à toutes ces personnes qui, dans le monde, se sont exclamées : « nous préférons le virus à la faim ». Mais dans nos sociétés, il existe aussi une élite à fort pouvoir d’achat, urbaine, gavée au point de s’inventer des peurs alimentaires parce qu’elle a oublié la peur de manquer. C’est elle qui se permet de recommander des modèles où l’on produit moins pour plus cher, au prix d’une forte pénibilité et d’une grande précarité. Ce n’est ni réaliste, ni sérieux !
Vous dites : Vladimir Poutine est le roi de la betterave. Le réchauffement climatique est-il son allié ?
Bien sûr. Le réchauffement climatique libère d’immenses terres cultivables aux hautes latitudes, donnant au plus grand pays du monde, la Russie, avec ses 11 fuseaux horaires, la possibilité de devenir maître du blé, de la betterave et du maïs, comme elle est maître du gaz. Elle dispose en outre d’excellentes terres cultivables, les chernozems, ou tchernozioms, qui lui donnent un véritable avantage agronomique – même si ses rendements restent encore limités parce que les techniques agricoles sont loin d’égaler les nôtres. Mais la France ne dispose que de 5 % de la surface agricole utilisée (SAU) mondiale… Ce qui ne l’a pas empêchée d’être pendant longtemps le deuxième exportateur mondial de nourriture, position qu’elle a hélas perdue.
Comment voyez-vous l’avenir de la betterave dans un monde dominé par la canne à sucre ?
Parce qu’elle est une culture locale, de proximité, qu’elle bénéficie du changement climatique (à condition de régler la question de l’eau et de la pression parasitaire), la betterave a de multiples atouts à faire valoir : elle apporte des réponses dans tous les domaines et la filière ne cesse de progresser en termes de développement durable et d’économie circulaire.
Quels conseils donneriez-vous à un producteur de grandes cultures pour mieux se faire entendre et communiquer vers nos concitoyens ?
Faire auprès du grand public une belle démarche d’information et de communication pour que les gens se mettent à aimer les champs de betteraves, les tas de betteraves au bord des routes à l’automne (je viens du Nord !), la silhouette des sucreries dans le paysage, en se disant : « je suis fier d’être issu d’une région où existe une telle culture, qui sauve les territoires, l’emploi, l’écologie, qui crée des richesses et apporte des réponses concrètes aux grands défis du monde ».
Comment le sucre devrait-il communiquer ?
Le sucre subit une crise de saccharophobie injuste comme le beurre a été longtemps discrédité face à l’huile. Le sucre c’est pourtant l’aliment du bonheur et de l’intelligence. Ce n’est pas un hasard si, jusqu’au 18e siècle, il était vendu par les apothicaires. Quand on parlait de dénuement on disait « comme un apothicaire sans sucre ». Dans Madame Bovary, le pharmacien Homais met des aliments sucrés dans sa vitrine. D’ailleurs, le glucose est un carburant essentiel pour le cerveau (2 % du poids corporel mais 20 % de glucose de l’organisme). N’oubliez pas que vous produisez l’aliment du bonheur, du plaisir, de l’intelligence. On vient d’ailleurs de comprendre que ses succédanés de synthèse engendraient des problèmes cardiovasculaires et cérébraux. C’est le moment de le réhabiliter : voilà un aliment naturel dont le monde a faim !