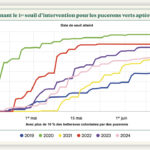Les conditions de semis ont été globalement favorables, cette année. Les travaux ont commencé avec un mois d’avance par rapport à 2024, ce qui est un bon signe pour la productivité des cultures.
Le 20 mars marque la date médiane des semis. Les semis effectués avant cette date présentent une croissance satisfaisante, à l’exception des zones impactées par les orages des 15 et 16 mars, notamment dans le sud de Paris et en Normandie. Ces précipitations intenses ont provoqué la formation de croûtes de battance et favorisé l’apparition de limaces, ce qui a eu un impact sur la levée des betteraves dans certaines parcelles.
Après cette date, un vent de nord sec a rapidement desséché les sols, nécessitant une grande réactivité dans les interventions culturales : limitation des préparations et semis rapides après préparation pour préserver la qualité de germination.
Des dégâts dus aux mulots ont été signalés, en particulier dans les parcelles aux sols motteux ou argileux, où les graines étaient insuffisamment enfouies.
Les parcelles en non-labour ont été plus faciles à préparer cette année, ce qui illustre les bénéfices de cette technique de gestion des sols. En revanche, la préparation des terres labourées a été plus complexe, notamment en raison de la rareté de labours de qualité, accentuée par les pluies.
Le parasitisme souterrain reste limité à ce stade, en partie à cause du déficit hydrique. Une vigilance reste néanmoins de mise si les conditions venaient à évoluer.
Les premiers traitements herbicides sont en cours. Maintenir une bonne propreté des parcelles reste essentiel pour limiter la concurrence des adventices. Des interventions mécaniques, notamment à la herse étrille, ont également été conduites dans le cadre des essais du PARSADA (voir encadré).
Les expérimentations menées dans le cadre des du PNRI-C et du projet AGIR visent à mieux comprendre les dynamiques de pucerons et de jaunisse, et devraient apporter des éléments utiles pour la gestion de ces bioagresseurs.
Ce plan d’action vise à limiter la jaunisse en Beauce, où les zones de production de betteraves porte-graines coïncident avec celles dédiées à la production sucrière. En complément des protections aphicides disponibles, une combinaison de leviers agronomiques et biologiques est mobilisée, avec pour objectif de réduire les populations de pucerons verts vecteurs du virus :
• Plantes compagnes (avoine et orge de printemps) : implantées sur plus de 200 hectares, elles émettent des composés volatils susceptibles de perturber les pucerons et de limiter leur installation sur les betteraves.
• Épandage de kairomones : ces substances odorantes influencent le comportement des pucerons en perturbant leur alimentation, leur reproduction et leur attraction pour les cultures, favorisant ainsi une régulation biologique des populations.
• Lâchers de chrysopes : des lâchers de chrysopes sont réalisés sur environ 100 hectares. Les larves de cet insecte auxiliaire consomment jusqu’à 60 pucerons par jour, contribuant à une réduction naturelle des infestations.
• Cartographie et suivi des pucerons : des capteurs (photo) sont déployés afin de détecter à distance l’arrivée des pucerons, facilitant une intervention ciblée et rapide.
Dans le cadre des essais du Parsada, la délégation de l’Aisne à mis en place en 2025 plusieurs expérimentations ciblant des parcelles confrontées à une problématique graminée.
Deux types d’essais sont menés :
· Le passage d’une herse étrille avec réglage de la pression des dents en pré-levée et post-levée selon le stade de la culture.
· L’application localisée d’herbicide sur le rang, associée au binage.
Ces essais seront suivis jusqu’à la récolte, afin d’évaluer l’impact des différentes stratégies sur la productivité, en identifiant leurs effets positifs ou limitants.
Dans une parcelle présentant des difficultés récurrentes de gestion des vulpins, un essai de faux-semis a été mené en décalant la date de semis de huit jours. À ce stade, compte tenu des conditions sèches de l’année, aucune différence notable entre modalités n’a été observée.
Dans cette même parcelle, un passage à l’aveugle avec herse étrille à câble a été effectué huit jours après le semis, alors que les betteraves étaient en germination. Les graines avaient été positionnées en moyenne à 2,5 cm de profondeur, ce qui a permis de travailler avec une herse étrille à câble (seul ce type de machine peut permettre cette intervention à ce stade). Trois semaines après le semis, peu d’impact est observé sur la densité finale. Cependant, en raison du travail sur le rang en pré-levée, l’installation est fortement ralentie : les graines sont plus enfouies, ce qui allonge le temps d’émergence.
Compte tenu des semis précoces cette année et des conditions spécifiques (sols superficiellement secs, vent fréquent), la dynamique de levée des adventices est atypique. Une certaine prudence sera nécessaire dans l’interprétation des résultats.