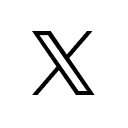Pensez-vous que les biosolutions gagnent en importance dans les rotations betteravières et les grandes cultures ?
Alexandre Quillet : je dirais à la fois oui et non ! Effectivement, la situation s’est améliorée par rapport à il y a dix ans, mais l’utilisation des biosolutions reste limitée en rotation betteravière et grandes cultures, surtout comparée à la vigne. En tant qu’agriculteurs, nous sommes ouverts aux nouvelles solutions et, au sein de l’Institut technique de la betterave (ITB), nous nous sommes engagés dans leur expérimentation. Au sein de mon exploitation, j’utilise trois produits de biocontrôle avec succès : du soufre pour le lin textile, un fongicide à base de Bacillus contre le sclérotinia du colza, et des antilimaces formulés avec du phosphate ferrique.
Depuis 2017, l’ITB est partenaire du Contrat de Solutions. À travers des échanges avec les membres de l’organisation IBMA France, maintenant Alliance Biocontrôle, je constate que de nombreuses entreprises investissent fortement dans la recherche de solutions de biocontrôle. Cela dit, notre approche reste pragmatique : nous sommes prêts à réduire les phytosanitaires au profit du biocontrôle si leur efficacité et leur coût sont satisfaisants. Mais, pour baisser les prix, il faut un déploiement à grande échelle, et on se retrouve avec le problème de la poule et de l’œuf !
Quelle est la place des biosolutions dans la stratégie des entreprises de protection des cultures ?
Yves Picquet : en santé des plantes, nous visons une triple performance pour l’agriculture : économique, sociétale et environnementale. Les agriculteurs doivent y trouver leur compte sinon le système ne tient pas, la nourriture doit être saine, de qualité et abordable. Enfin, les pratiques doivent contribuer à réduire leur empreinte sur l’environnement. C’est dans cette optique que nous investissons dans les biosolutions.
Néanmoins, au niveau de Phyteis, nous prenons très à cœur notre modèle combinatoire de la protection des cultures. Ce modèle se fonde sur les biosolutions, le digital, la génétique et la phytopharmacie. Il s’appuie aussi sur les pratiques agricoles. Ces dernières jouent un rôle essentiel mais sont insuffisamment référencées. Je pense notamment aux rotations, aux couverts végétaux qui sont à croiser avec chaque condition climatique et de sol. Enfin, il est essentiel de ne pas opposer chimie et biosolutions. Ce n’est pas parce qu’un produit est chimique qu’il est à écarter. On est encore un peu trop dans ces schémas-là ! Par exemple, chez Bayer, 1 000 chercheurs développent des solutions chimiques avec un meilleur profil écotoxicologique. Nous avons besoin des deux pour une agriculture performante et durable.
Pour développer les biosolutions : quelles sont les priorités ?
Yves Picquet : clairement, l’enjeu pour accélérer le déploiement des biosolutions se retrouve du côté de l’accompagnement par tous les acteurs : instituts techniques, chambres d’agriculture, conseillers privés et distribution agricole. Ces deux catégories de structures interviennent au quotidien auprès des agriculteurs et établissent une relation de confiance. Toutefois, pour la distribution agricole, la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques s’avère contreproductive pour le biocontrôle.
Ensuite, les données disponibles sont souvent partielles et l’utilisation des biosolutions nécessite une approche différente, plus holistique. Leur efficacité dépend de leur positionnement au sein de l’itinéraire cultural, en combinaison avec d’autres techniques et selon les conditions agronomiques de la parcelle. Dans ce cas, en tant que fabricant, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la diffusion de ces bonnes pratiques.
Alexandre Quillet : oui, nous avons besoin d’accompagnement pour changer les méthodes. Les biosolutions doivent alors être abordées selon deux perspectives : celle des utilisateurs et celle des conseillers, qui ont chacun une approche distincte. Pour les utilisateurs, elles nécessitent une prise en main spécifique adaptée à l’exploitation. Et pour les conseillers, cela suppose une nouvelle manière de proposer le conseil.
Cela concerne en particulier les biostimulants qui se concentrent sur la santé globale de la plante. Le sujet gagne de l’importance depuis ces cinq dernières années. Dans ce cas, plutôt que de répondre à un problème par une solution, l’approche vise désormais à combiner différentes solutions pour optimiser la culture dans son ensemble. C’est un grand changement. Lorsqu’un représentant d’ONG environnementaliste me demande ce que je fais pour améliorer les choses, je réponds systématiquement : arrêtons de réduire les solutions à une liste unique, applicable à toutes les exploitations françaises. L’agriculture ne fonctionne pas ainsi. Chaque exploitation est unique et chaque parcelle aussi. Pour réussir, il nous faut une boîte à outils diversifiée et des conseillers agricoles formés pour adapter les solutions à chaque situation.
Et du côté de l’offre, où en êtes-vous ?
Yves Picquet : je dirais qu’actuellement nous vivons une période très riche en termes de recherche mais aussi d’approche agronomique. La boîte à outils est en train de se constituer.
En effet, avec les biocontrôles comme les biostimulants, nous sommes au début de l’aventure ; le champ des possibles est considérable. Les entreprises telles que les nôtres travaillent avec des start-ups. C’est l’innovation ouverte.
Quand on discute avec les chercheurs, tous nous certifient que pour obtenir une chimie efficace, il leur a fallu 30 à 40 ans. Donc, je pense qu’il faut laisser le temps à la science et à l’innovation d’arriver. Et je suis sûr que, dans le futur, nous aurons des produits d’origine naturelle qui seront tout à fait aussi efficaces que ceux d’origine chimique.
Enfin, en betterave, il me semble que les pistes en biocontrôle sont du côté des kairomones pour perturber les pucerons. Pour les biostimulants, elles se développent en traitement de la semence, du sol et de la plante pour le démarrage et la croissance.
Comment appréhendez-vous les biostimulants et les biocontrôles en tant qu’agriculteur et au niveau de l’ITB ?
A.Q. : évidemment, il nous est impossible d’explorer tous les modes d’action des biostimulants. En tant qu’agriculteur, je ne peux donc pas tout adopter immédiatement, d’autant plus que l’offre est vaste. C’est là que les instituts techniques jouent un rôle crucial : ils doivent répondre aux questions essentielles. Est-ce que c’est efficace ? Est-ce que c’est rentable ? Est-ce que les résultats sont répétitifs et fiables ? Ce sont les interrogations auxquelles ils doivent apporter des réponses claires.
De même, le succès d’un produit de biocontrôle est lié à son efficacité mesurée et annoncée par un organisme indépendant de la commercialisation du produit. Pour cette raison, j’encourage toujours les firmes à travailler de concert avec les Instituts techniques agricoles. Si le produit de biocontrôle nécessite des conditions d’emploi particulières, il sera alors indispensable de bien accompagner les agriculteurs dans leur bonne utilisation pour maximiser leur efficacité.
Comment peut-on qualifier les bénéfices des différentes biosolutions ?
Y.P. : je partage ce besoin de preuves concrètes. Le biocontrôle cible spécifiquement les bioagresseurs pour protéger la plante, tandis que le biostimulant la prépare à faire face aux stress, qu’ils soient abiotiques ou biotiques, en renforçant sa résilience. Cependant, son action est moins ciblée et moins prévisible qu’un produit chimique ou de biocontrôle.
Je compare les biostimulants à des vitamines : leur effet est plus visible les années avec des accidents climatiques ou si les plantes sont fragilisées. L’expérimentation de ces produits nécessite donc une approche différente. Les essais en petites parcelles sont, selon moi, peu pertinents ; il est préférable de les tester en grandes parcelles pour bien prendre en compte les variations du potentiel agronomique. D’ailleurs, le numérique avec l’imagerie satellite nous aide à mesurer ces variations intraparcellaires.
Des technologies sont-elles aussi à développer en complément des biosolutions pour bien les utiliser ?
Y.P. : le digital permet de bien positionner les biosolutions. Les nouvelles techniques génomiques accélèrent l’obtention de variétés résistantes aux bioagresseurs et aux aléas climatiques. Néanmoins, l’idée est d’avoir une offre plurielle. Dans un système de culture, il faut intégrer la génétique, les produits chimiques, le biocontrôle et l’agronomie. C’est cette vision d’ensemble qui permet au conseiller de dire : « voilà comment optimiser ton exploitation et tes parcelles ». Ce n’est pas un produit isolé qu’on recommande, mais une approche globale.
A.Q. : tout à fait. La technologie des semences est très prometteuse. En parallèle, des investissements massifs soutiennent des projets ambitieux, comme ceux de Parsada, un programme orienté par les instituts techniques agricoles. Mais il est essentiel de renforcer également le déploiement des bonnes pratiques agricoles, souvent encore méconnues. Il ne s’agit donc plus de se concentrer uniquement sur les 25 à 30 % de pionniers. Un immense travail reste à faire pour diffuser ces méthodes et encourager l’adoption des biosolutions.
Quelle est la place des biosolutions dans le PNRI et quelles sont les perspectives de recherche ?
A.Q. : le biocontrôle est l’une des quatre solutions retenues dans le PNRI-C (2024-2026) et déjà présente parmi les 23 projets initiaux du PNRI lancé en 2021. Nous avons toujours un screening des nouveaux produits de biocontrôle, d’abord en laboratoire puis sur grandes parcelles, preuve de l’intérêt que nous y portons. Mais nous avons retenu un projet étudiant l’incorporation de composés organiques volatils (COV) autour de la semence. Les tests ont révélé l’incroyable sens olfactif des insectes, bien supérieur à celui des chiens. C’est ainsi qu’Agriodor a développé son répulsif. Au début, l’entreprise proposait 10 000 petits diffuseurs à positionner par hectare, ce qui était irréaliste. En échangeant avec les agriculteurs, elle a conçu des granulés à épandre, rendant l’application bien plus pratique.
Aujourd’hui, nous ne visons plus une alternative simple aux néonicotinoïdes, mais un itinéraire complet, de la semence à la récolte : variété tolérante, semence protégée, semis de betterave avec plantes compagnes, biocontrôles en granulés et insecticides foliaires si nécessaire. En prime, des parasitoïdes seraient prêts à éliminer les pucerons au printemps. Ainsi, si nous tenions 7 à 9 semaines, nous passerions la phase critique. Résultat attendu d’ici 2 à 4 ans…
Quels sont les autres besoins en recherche et projets ?
Y.P. : contre les insectes, il reste un immense travail car les outils traditionnels disparaissent les uns après les autres. Le PNRI en est un bon exemple de fonctionnement pour la recherche : tous les acteurs se rassemblent pour compléter le puzzle. Là où chaque trou avait autrefois sa pièce unique, il faut désormais tester plusieurs solutions. C’est la même chose pour le Parsada, un plan très bien structuré, tout comme le plan de sortie du phosmet.
Cependant, dans la recherche de solutions pour éviter les impasses techniques, n’écartons pas la phytopharmacie. Chez Phyteis, nous réalisons avec l’appui des filières un état des lieux de la boîte à outils par culture. Nous le partageons dans le cadre de la collection de fiches « Engagés pour nos cultures ».
A.Q. : oui, le modèle du PNRI qui a inspiré le Parsada est un bon exemple à suivre. Les filières sont à la manœuvre. Les instituts techniques pilotent le comité de coordination technique. Ainsi, nous pouvons valider le volet économique, et l’Inrae joue son rôle scientifique. Autre exemple : le grand défi du biocontrôle et des biostimulants qui a permis la création de ABBA, association dans laquelle nous sommes intégrés. Enfin, côté besoin, je m’aperçois qu’il n’y a plus d’entomologistes en France. Nous avons besoin de ces compétences pour aller plus loin dans l’utilisation des auxiliaires. On devrait aussi travailler davantage les projets de recherche avec les universités et les écoles d’ingénieurs.