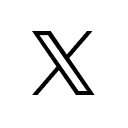À l’échelle de la France, l’agriculture est responsable de 19 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), réparties à peu près équitablement entre les productions végétales et l’élevage. Selon le référentiel Eges de 2016 (Arvalis, Terres Inovia et ITB), les émissions d’un hectare de blé fertilisé avec de l’ammonitrate se répartissent à peu près de la façon de la façon suivant : 27 % pour la fabrication de l’engrais, 60 % pour les émissions au champ et 17 % pour les autres utilisations d’énergie.
L’utilisation du méthane émet du CO2
L’azote minéral est obtenu en deux étapes. Tout d’abord, le diazote de l’air est combiné avec de l’hydrogène pour donner de l’ammoniac (NH3). Cette réaction chimique porte un nom bien connu : le procédé Haber-Bosch, du nom de ses créateurs. Dans un deuxième temps, l’ammoniac est transformé en ammonitrate, en urée ou en solution azotée.
La production d’ammoniac à partir du méthane émet du CO2. 80 % du gaz est utilisé comme matière première pour l’hydrogène et 20 % pour l’énergie nécessaire à la réaction. Grâce aux progrès de la science, il est maintenant possible de remplacer le gaz utilisé comme matière première par de l’eau, que l’on électrolyse. On peut alors aussi remplacer le méthane « énergie » par de l’électricité. Si l’électricité utilisée est produite à partir de sources bas carbone, l’hydrogène, puis l’ammoniac sont dits « verts ». Ce dernier n’émet que 250 kg de CO2 par tonne, alors que le « gris » (issu du procédé classique) en émet 2 tonnes. Selon Delphine Guey, présidente de l’Unifa, l’interprofession des producteurs d’engrais, et directrice de la communication chez Yara, le développement de l’ammoniac vert permettra de réduire l’empreinte carbone du blé de 20 % et celle du pain de 12 %.
La décarbonation de l’urée par l’électrolyse de l’eau est théoriquement possible mais ne peut être que partielle puisque la molécule CO(CH2)2 est fabriquée à partir d’une recombinaison de l’ammoniac avec une partie du CO2 issu du méthane, qui sera émis au champ. Pour une décarbonation totale, il faudrait utiliser du biogaz, mais les besoins seraient énormes et bien supérieurs à la production actuelle. La solution azotée étant un mélange d’urée et d’ammonitrate à parts égales, les émissions de GES sont égales à la moyenne des émissions des deux formes d’engrais. Dans la réalité, il ne semble pas que la production d’urée ou de solution azotée verte fasse partie des priorités des industriels de la fertilisation.
L’hypocrisie du courant écologique anti-nucléaire
C’est l’origine de l’électricité utilisée qui nous renseigne sur la réalité de la décarbonation. Proviendra-t-elle d’énergies renouvelables (ENR) intermittentes ou d’énergie bas carbone non intermittente (nucléaire ou hydroélectricité) ? En d’autres termes, le fonctionnement de l’usine d’ammoniac vert est-il compatible avec un approvisionnement intermittent d’électricité ? Delphine Guey est très claire : « en raison du process industriel, et des conditions de hautes températures et de hautes pressions, une usine de fabrication d’engrais minéraux azotés ne s’arrête pas et ne se redémarre pas aisément et rapidement. Chez Yara, nous le faisons une à deux fois par an pour des contrôles préventifs et réglementaires, et également pour des innovations technologiques. Il faut compter plusieurs jours pour l’arrêt de l’usine et autant pour son redémarrage avec un impact financier important ». Son fonctionnement peut être comparé à celui d’une sucrerie. La décarbonation de la production d’engrais n’est donc pas compatible avec les ENR intermittentes, à moins que ces dernières soient couplées avec de l’énergie pilotable, c’est-à-dire issue de centrales à gaz ou à charbon (non décarbonées). Comme la France ne dispose pas de ressources hydroélectriques très importantes, le nucléaire apparaît comme la seule énergie bas carbone capable de décarboner la production d’engrais agricole. C’est d’ailleurs probablement dans ce sens que Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies a déclaré le 23 novembre dernier à l’Assemblée nationale : « ce n’est pas 6 ou 10 réacteurs qu’il faut faire en France si on a de l’ambition sur l’hydrogène vert, c’est 15 ou 20 ! ».
Par ailleurs, Delphine Guey annonce que l’engrais minéral azoté décarboné sera plus cher que l’engrais classique, au moins dans un premier temps. Le différentiel de coût des deux technologies devrait dépendre des prix du gaz et de l’électricité. Sur quelle énergie faut-il donc miser ? Fabien Bouglé, expert en politique énergétique, estime que, sur le long terme, l’énergie éolienne est 10 fois plus chère que l’énergie nucléaire historique, en puissance installée. Et selon Jean-Marc Jancovici, le célèbre ingénieur en énergie et en climat, « la logique voudrait qu’à terme et dans un monde où l’énergie sera rare, la quantité d’argent à mobiliser pour produire une tonne d’hydrogène bas carbone soit une fonction croissante de la quantité de matériaux (et notamment de métaux) qui aura été mobilisée pour cette production. Or, le solaire ou l’éolien demande intrinsèquement 10 fois plus de certains métaux (cuivre notamment) pour produire un MWh. Cela plaide pour que le nucléaire redevienne moins cher que les ENR, et cela se transpose directement sur l’électrolyse de l’hydrogène ».
La décarbonation massive de la production d’engrais azoté nécessitant une très grande quantité d’énergie, elle semble intrinsèquement liée au développement de la filière nucléaire. La dénonciation de l’impact carbone des engrais azotés par les mouvements écologistes anti-nucléaire n’est-elle donc pas une hypocrisie ? Par ailleurs, n’y a-t-il pas un paradoxe entre le dynamisme et l’accompagnement du ministère de l’Industrie dans la décarbonation des engrais, dont témoigne Delphine Guey, et la fermeture de Fessenheim en 2020 ?
À l’avenir, la réalité de la décarbonation de l’azote dépendra de sa provenance. Pour l’instant, la production française ne couvre que 40 % des besoins, et une toute petite part de l’ammoniac est produite en France. La majorité est produite à l’étranger (souvent à proximité des gisements de gaz) et importée pour être transformée en ammonitrate, urée ou solution azotée. Mais si l’on veut, d’une part, gagner en souveraineté alimentaire, et d’autre part, décarboner l’engrais, ne faudrait-il pas envisager un développement de la production d’ammoniac sur le territoire national ? Par ailleurs, d’autres secteurs économiques envisagent de se tourner vers l’ammoniac vert comme le fret maritime.
Les industriels ont aussi développé l’ammoniac bleu, qui n’émet que 800 kg de CO2 par tonne. C’est-à-dire que le carbone émis lors du procédé Haber-Bosch est capté puis stocké dans des anciens puits de pétrole, selon une procédure très contrôlée. Selon Delphine Guey, il s’agit d’une bonne solution de transition avant la généralisation de l’ammoniac vert.
La technologie catalytique, un progrès écologique mal connu
La deuxième partie de la production consiste à transformer l’ammoniac en engrais azoté. Pour l’ammonitrate, cela passe par une étape intermédiaire de production d’acide nitrique, qui produit du protoxyde d’azote, un puissant gaz à effet de serre. Comme l’explique l’Unifa, un nouveau procédé de catalyse mis en place dans les usines de production d’engrais de France et d’Europe élimine plus de 90 % du N20, et jusqu’à 99 % pour certaines usines, comme celle de Yara à Montoir-de-Bretagne. « Cette innovation a permis une diminution de 50 % des émissions de GES liées à la production des engrais azotés », explique Delphine Guey. Mise en place indépendamment de toute contrainte réglementaire, elle reste malheureusement complètement méconnue du grand public, et même de nombreux agriculteurs. Pour la production d’urée, la technologie catalytique n’est pas utile car le processus n’émet pas de N2O.
Pour les émissions qui ne sont pas liées à l’azote, plusieurs leviers sont aussi mobilisables : la réduction, voire l’abandon du travail du sol, l’investissement dans du matériel d’irrigation moins gourmand en énergie et dans des séchoirs fonctionnant avec des énergies moins carbonées, la culture de maïs et de tournesol plus précoce (pour diminuer l’humidité à la récolte). Pour toutes les machines fonctionnant à l’électricité, comme les pompes pour l’irrigation ou les vis de silo, le niveau de décarbonation dépend du mix énergétique.
Les émissions de N2O au champ nous échappent encore
Une fois l’engrais épandu, l’urée (CO(NH2)2) est transformée en ammonium (NH4+), en émettant du CO2. En effet, les plantes ne peuvent pas, ou quasiment pas, absorber d’azote sous forme organique. Par ailleurs, l’azote issu de la minéralisation de la matière organique du sol, ou d’autres sources organiques, passe aussi par des procédés comparables. L’ammonitrate n’est pas soumise à ce processus, car cette molécule n’a pas été recombinée avec du carbone en usine.
Ensuite intervient le processus de nitrification. C’est la transformation de l’ammonium en nitrate par des bactéries en condition aérobie. Ce phénomène émet du N2O mais les scientifiques ne connaissent pas encore clairement les paramètres agissant sur la quantité libérée au cours de ce processus qui peut se prolonger par la dénitrification du nitrate produit, aussi source de N2O. Selon Cédric Boudes, plus le procédé va s’arrêter sur des étapes intermédiaires, plus les émissions de N2O seront importantes. « Imaginez un tuyau percé qui relie l’épandeur d’engrais à la plante : les pertes sont inévitables, mais plus le transfert sera rapide, moins elles seront élevées », explique l’ingénieur agronome qui recommande donc d’épandre l’engrais dans des conditions propices au bon fonctionnement du sol. L’ensemble de l’urée et de l’azote organique est soumis à ce processus, mais seule la partie ammonium de l’ammonitrate (50 %) subit la nitrification.
Limiter l’effet « salle d’attente »
Une fois que l’azote est sous forme de nitrate, il est disponible pour la plante. Mais l’ion doit rester le moins longtemps possible sous cette forme, car il est alors sensible à la dénitrification. Cette transformation, qui est responsable des plus fortes émissions de N2O observées au champ, est le processus respiratoire de certains micro-organismes en condition anaérobie. Il ne pose pas de problème environnemental quand il est complet car il aboutit à l’émission de N2, un gaz stable sans contribution à l’effet de serre. Mais il peut s’arrêter à la production de N2O, surtout dans un sol acide (pH<6,5). En complément de l’ajustement de l’apport d’azote aux besoins de la plante, un premier levier de réduction des émissions sera donc de s’assurer de l’aération du sol, par exemple par le drainage, la gestion de l’irrigation et la lutte contre la compaction des sols, particulièrement lors des apports d’azote. « À partir de 60 à 70 % de saturation en eau du sol, les émissions de N2O augmentent de façon exponentielle », explique Catherine Henault, directrice de recherche à l’Inrae. Un autre levier sera de relever le pH du sol au-dessus de 6,8 par un chaulage pour permettre la transformation du N2O en N2. Mais comme seuls les nitrates non absorbés par la plante peuvent être soumis à la dénitrification, Cédric Boudes recommande de limiter au maximum ce stock. C’est ce qu’on peut appeler l’effet « salle d’attente ». C’est ce qui fait dire à Stéphane Jézéquel, directeur scientifique d’Arvalis, que, si la sous-fertilisation ne réduit que très peu les émissions de protoxyde d’azote, la sur fertilisation est très polluante. Il préconise d’ajuster la dose d’azote disponible dans le sol (apport + fourniture du sol) avec le besoin de la plante à un instant T. Outre la méthode du bilan, l’agronome conseille de s’aider d’Outils d’aide à la décision (OAD), voire de la modulation intra parcellaire pour optimiser la dose et la date du ou des apports.
20 % d’abattement avec des inhibiteurs
Une autre solution possible est l’utilisation d’inhibiteurs de nitrification qui vont lisser la libération du nitrate dans le temps pour éviter les à-coups et coller au plus proche aux besoins du blé, explique Stéphane Jézéquel. « L’idéal est que l’azote soit absorbé par la culture dès sa nitrification », précise-t-il. Selon la méthode du label bas carbone, ces additifs peuvent permettre une réduction de 20 % des émissions de N2O, explique Yohan Merieau, le directeur de Fertiline, la branche engrais d’InVivo. Le chiffre de -50 % est même annoncé dans certains essais. Mais cette pratique a un coût qui n’est pas payé par les économies d’azote. En effet, les quantités d’azote émises sous forme de N2O sont très faibles (de l’ordre de quelques unités par hectare) malgré un impact important sur le climat, car le protoxyde d’azote a un fort pouvoir de réchauffement climatique.
Enfin, Catherine Hénault et son équipe de l’Inrae travaillent sur un projet de recherche qui porte sur certains rhizobia, bien connus dans le processus de fixation symbiotique, qui auraient aussi la capacité de réduire le N2O en N2. Ce levier est encore à l’état d’expérimentation.
Indépendamment de ces trois leviers, l’agronome explique qu’il existe globalement une relation entre la quantité d’azote apportée aux sols et leurs émissions de N2O. Les calculs actuels d’inventaire, basés sur les méthodologies proposées par le GIEC (2006), considèrent qu’1 % de l’apport azoté ou de la fourniture du sol est transformé en N2O. Mais attention, sans son intervalle de confiance, ce chiffre ne prend pas en compte la très forte variabilité des émissions, liées aux conditions pédoclimatiques ainsi qu’aux formes d’azote apportées, précise Catherine Hénault. Quoi qu’il en soit, la gestion des apports d’azote aux cultures est le premier levier pour faire baisser les émissions de N2O.
Selon Yara, l’ammonitrate est non seulement la forme d’engrais qui émet le moins, mais aussi celle qui présente le plus grand potentiel de décarbonation à l’avenir.
Légumineuse et azote organique
La fixation symbiotique de l’azote par la culture des légumineuses est une autre piste à étudier. L’azote synthétisé par ces plantes n’émet ni de GES pendant la synthèse (contrairement aux usines d’engrais), ni de N2O au champ, puisque l’azote est synthétisé directement dans les racines de la plante. En revanche, l’azote résiduel présent dans les résidus de récolte et dans le sol, tout comme celui présent dans les effluents d’élevage, les digestats, les composts et les boues de station d’épuration seront soumis au même processus biologique de nitrification/dénitrification avant leur absorption par la culture. L’agriculture biologique n’est donc pas dénuée d’émissions de N2O. Par ailleurs, la libération de l’azote organique est moins pilotable que celle de l’azote minérale. Des méthodes de suivi de la minéralisation existent, mais ce nitrate peut se retrouver dans le sol à un moment où aucune plante n’a la capacité de l’absorber. Cependant, les sources d’azote organique émettent moins de protoxyde d’azote par unité apportée que l’azote minéral. Trois fois moins selon Stéphane Jézéquel, ce qui sera pris en compte dans les futurs calculs d’inventaire mobilisant la méthodologie GIEC publiée en 2019.
Les autres formes d’émission/transfert de l’azote (volatilisation ammoniacale, lessivage des nitrates, …) peuvent conduire à des émissions indirectes de N2O, mais en plus petites quantités. Il est donc aussi important de les limiter.
Il faut retenir que les émissions au champ sont la partie la plus difficile à contrôler, car ce sont des processus biologiques et diffus qu’on maîtrise difficilement, explique Stéphane Jézéquel. En effet, il est plus simple de contrôler un processus chimique en usine que l’activité de bactéries réparties sur toute la surface de la planète et sensible à la variation des conditions climatiques.
Stéphane Jézéquel précise que les émissions sont à comparer avec la quantité de CO2 captée, et particulièrement avec le carbone stocké dans le sol, pour connaître le bilan carbone d’une culture. C’est ce que propose la méthode label bas carbone grandes cultures, qui propose les leviers présentés ici (dose d’azote apportée, chaulage des sols, condition d’apport et utilisation d’inhibiteurs de la nitrification) pour réduire les émissions de N2O. Cette méthodologie permet aussi de prendre en compte la capacité de production, qui reste l’objectif principal de l’activité agricole.