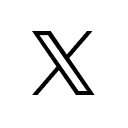La filière a été touchée de plein fouet par la jaunisse. La réponse de l’État a-t-elle été à la hauteur ?
Oui, l’État a été à la hauteur, puisque le premier objectif était de permettre l’enrobage des semences avec des néonicotinoïdes pour les prochains semis. Aujourd’hui, sauf si le Conseil constitutionnel s’y oppose, c’est chose faite. À ce stade, l’État a joué son rôle et je tiens à remercier le ministre de l’Agriculture et ses collaborateurs, ainsi que les Parlementaires qui ont voté cette loi.
Quelles sont les dernières étapes à franchir avant la sortie des décrets d’application ?
La décision du Conseil constitutionnel est attendue avant le 10 décembre. Si le texte est conforté, des décrets et arrêtés devraient être mis en consultation publique mi-décembre. Il faut également attendre un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui doit alimenter la rédaction de ces textes réglementaires. Ensuite, un Conseil de surveillance sera mis en place, il sera chargé de suivre l’évolution de la situation sur la jaunisse et d’émettre un avis sur les dérogations.
Je souhaite éviter que l’on se retrouve dans la situation où la dérogation existe, mais avec des critères d’accès trop restrictifs sur les cultures de plantes mellifères dans la rotation. Cela a été le cas en Belgique où seules 15 % des surfaces ont été traitées avec des néonicotinoïdes en 2020.
Où en est le dossier sur les indemnisations de la jaunisse ?
Le volet indemnisation avance plutôt bien. Le ministre va faire – je l’espère – des annonces le 10 décembre lors de notre assemblée générale. La CGB défend des références individuelles, autant sur le rendement effectif de l’année que sur les références historiques, pour tenir compte des spécificités de l’exploitation, comme l’irrigation ou le potentiel des sols. Il faudrait également aller au-delà des 5 ans pour le calcul de la moyenne, de manière à atténuer les deux années de sécheresse.
Il y a en revanche un aspect qui nous inquiète. Le dispositif de minimis n’est pas adapté, car il plafonne les aides à 20 000 € par exploitation sur 3 ans. De nombreux agriculteurs sont déjà au taquet à cause d’aides perçues par ailleurs : je pense aux éleveurs ou à ceux qui ont déjà été touchés par des aléas climatiques. Ces agriculteurs ne toucheront aucune aide. Ce n’est pas équitable.
Que faire pour aller au-delà des aides de minimis ?
L’objectif est de trouver une solution pour adosser un dispositif aux aides de minimis de manière à tenir compte de toutes les particularités, et surtout que des exploitations de taille supérieure à la moyenne nationale puissent également être éligibles. Elles représentent tout de même 45 % des surfaces betteravières en France ! Les planteurs sont très inquiets et j’ai été plusieurs fois interpellé sur cette question, lors des assemblées générales de syndicats betteraviers qui se sont tenues ces dernières semaines en régions.
Qui peut résoudre ce problème ?
C’est le ministre lui-même. Il doit nous donner son accord pour trouver un système parallèle. Les planteurs souhaitent connaître au plus vite le montant de leur indemnisation pour soulager des trésoreries exsangues et se projeter dans l’avenir. La CGB a œuvré pour la mise en place d’une aide à la trésorerie des exploitations. Depuis 15 jours, le dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) est accessible aux agriculteurs de grandes cultures, touchés par la sécheresse et la crise sanitaire.
Le plan national de recherche et innovation est-il suffisant ?
L’État a débloqué 7 M€. C’est très bien. Et si l’on ajoute tous les moyens financiers qui seront mis en parallèle par les semenciers, l’ITB et l’Inrae, cela représente des moyens considérables qui devraient déboucher sur des solutions d’ici trois ans. Ce plan va travailler selon une approche multifactorielle, et notamment sur des produits de biocontrôle et la tolérance des variétés. Dans cette perspective, l’adoption d’un cadre réglementaire adapté aux nouvelles techniques d’édition du génome sera cruciale pour la performance agroenvironnementale de nos productions végétales. Mais il restera sûrement des failles dans la protection des plantes. C’est pourquoi il faudrait mettre en place un outil capable de compenser les pertes sanitaires au cas où les solutions techniques ne seraient pas suffisantes. C’est à nous de travailler ce sujet.
Vous pensez à un outil assurantiel ?
Oui, à l’instrument de stabilisation du revenu (ISR), qui a été étudié pour le volet économique ces dernières années, mais qui pourrait aussi être utile pour couvrir des risques sanitaires.
Les sucriers ont toujours été frileux sur ce dossier…
C’est vrai, mais maintenant il en va aussi de l’avenir des industriels. Ils sont tous conscients du risque. Selon moi, ce dossier peut enfin décoller. D’ailleurs, l’ISR sera testé en 2021 pour qu’il soit prêt d’ici deux à trois ans. Ce simulateur sera financé par les régions qui ont compris l’intérêt de garder une filière sucrière sur leur territoire.
Que dites-vous aux planteurs qui seraient tentés de diminuer les surfaces en 2021 ?
Je leur dis que les voyants sont au vert sur le marché mondial du sucre. Les récoltes n’ont pas été très bonnes dans toute l’Europe, nous allons donc manquer de sucre. Le marché du gel hydroalcoolique est en plein boom et les prix de l’éthanol se tiennent globalement bien malgré les variations de cours. Aujourd’hui, les prix des betteraves se rapprochent des 25 €/t. Si l’on n’avait pas eu des rendements aussi catastrophiques, les sucriers auraient sans doute pu payer davantage les betteraves en faisant tourner leurs usines plus longtemps. Pour moi, c’est une bonne tendance. Il n’y a pas de raison que les prix n’aillent pas au-delà des 25 €/t l’année prochaine.
Les industriels vous ont-ils donné des indications de prix ?
On commence tout doucement à en avoir. Cristal Union a par exemple décidé de donner une prime de 1 €/t si l’agriculteur maintient ses surfaces. Tereos a une formule de prix connue par les planteurs. Mais, début janvier, il faudrait que l’on ait plus de précision sur les prix minimums que l’on pourrait toucher l’année prochaine. Il y a une vraie attente des planteurs. Nous sommes à la veille de commander des semences et, je le répète, les indicateurs sont au vert. L’enjeu numéro un est de maintenir les surfaces de betteraves.
Vous estimez donc que la betterave a toujours sa place dans la rotation…
Avec les néonicotinoïdes et des marchés à la hausse, clairement oui. En revanche, je pense qu’aucun betteravier ne sèmera sans avoir de garanties. Et il faut aussi raisonner à long terme : la réforme de la PAC qui s’annonce va imposer des rotations plus longues. On parle d’implanter cinq cultures, il y a donc de la place pour la betterave. La gestion du risque, c’est aussi ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Considérez-vous le dossier néonicotinoïdes comme une victoire syndicale ?
Nous avons réussi à rassembler tout le monde autour de ce combat. Ce dossier a bien montré la force du réseau FNSEA et Jeunes agriculteurs (JA) adossé à des organisations spécialisées. La CGB est une structure hyperspécialisée capable de porter un dossier aussi complexe pendant quatre mois d’affilée et de mobiliser des moyens humains. Un dossier tel que celui-ci ne peut aboutir qu’avec des hommes engagés à 100 %. Tout le travail de fond réalisé par la CGB pendant des années a payé. Sans syndicalisme, on n’aurait pas pu obtenir ce résultat.
Serez-vous aussi efficace après la fusion entre la CGB et les syndicats betteraviers ?
La CGB a mis en place une réorganisation profonde avec une restructuration des syndicats.
Cette fusion a été pensée pour optimiser au maximum le fonctionnement pour un meilleur service aux planteurs, tout en réduisant nos coûts de fonctionnement. Aujourd’hui, notre présence sur le terrain et l’esprit de la maison restent le même.
Quel est bilan de la première année de pacte avec la coopération ?
Vous imaginez bien que nous n’avons pas pu travailler ce dossier, car nous avons été accaparés par la jaunisse. Ceci dit, le combat que nous avons mené sur les néonicotinoïdes, nous l’avons gagné ensemble. Je tiens d’ailleurs à remercier tout particulièrement le président de Tereos, Jean-Charles Lefebvre, le président de Cristal Union, Olivier de Bohan, et le président de l’interprofession (AIBS), Jean-Phillippe Garnot.
Ce dossier est-il aussi révélateur d’un certain changement de vision vis-à-vis de l’agriculture ?
Le dossier des néonicotinoïdes démontre que l’agriculture a encore de l’avenir. La notion de souveraineté alimentaire est revenue au cœur des discussions. Le président de la République a pris conscience de l’importance du secteur sucrier au Salon de l’Agriculture, puisqu’il a nommé un délégué interministériel pour nous accompagner dans la gestion de crise. Et puis, nous avons un ministre qui comprend les choses.
Nos concitoyens formulent aussi beaucoup d’attentes sur l’environnement…
C’est légitime, mais ce que je demande, c’est : pas d’interdiction sans solution, sans alternatives. Car il faut faire attention à ne pas perdre notre indépendance alimentaire.
Le Sénat ne dit pas autre chose quand il préconise une étude d’impact à chaque fois que l’on supprime un produit phytosanitaire. Il souhaite par ailleurs appliquer les mêmes normes de production à tous les produits importés en Europe.
Comment voyez-vous la réforme de la PAC ?
Au niveau du budget, on s’en sort pas mal. À nous de donner de nouvelles perspectives ! Je rappelle que la première vocation de la PAC est économique et pas seulement environnementale. Le premier pilier est important pour nos régions de grandes cultures. Le deuxième pilier peut apporter des opportunités : améliorer la gestion des risques climatiques en abaissant la franchise des assurances récolte à 20 % et même aller au-delà sur le dossier de l’assurance revenu, car nous ne sommes plus protégés au niveau des marchés, du climat et de l’aspect sanitaire. Il faut également anticiper les changements à venir : je pense notamment au tout nouveau marché carbone où la betterave aura un rôle très important à jouer. Elle est une véritable pompe à carbone : un hectare de betteraves fixe environ 40 tonnes de CO2.
Comment abordez-vous le Brexit ?
Ce sujet est d’une importance capitale, car le Royaume-Uni est notre premier client.
La France exporte 300 à 400 000 t de sucre et 2 Mhl d’éthanol. Il faut surveiller les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, car ce pays représente un débouché de 10 à 15 % de nos surfaces betteravières selon les années. Nous appelons la Commission européenne à la plus grande vigilance quant à l’impact que cela pourra avoir sur l’équilibre du secteur européen. Il faut en particulier éviter des réexportations vers l’UE de sucres originaires du Brésil et raffinés au Royaume-Uni.