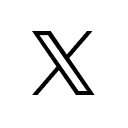Que vous inspire la dérogation accordée aux betteraviers concernant l’utilisation des néonicotinoïdes ?
C’est une décision sage. C’est toujours mieux qu’un retour aux pesticides d’ancienne génération. C’est une bonne décision pour l’industrie sucrière, car comment pourrait-elle supporter une baisse de rendement de 30 à 50 % ? C’est une bonne décision aussi pour l’industrie de la déshydratation, qui vit en partie grâce au traitement des pulpes de betterave. Sans elles, le coût de la déshydratation de la luzerne augmenterait fortement. Or, nous apiculteurs, vivons grâce à la luzerne. Si elle disparaît, nous disparaissons aussi. L’agriculture fonctionne comme un château de cartes.
Vous pensez que les néonicotinoïdes ne sont pas un danger pour les abeilles ?
Au début, j’ai cru, comme tout le monde, à l’hypothèse néonicotinoïdes responsables de la mortalité des abeilles. Il y a bien eu, à l’époque, une mortalité très importante provoquée par les pesticides, en l’occurrence le DDT et les organophosphorés. Les traitements aériens effectués sur les champs de céréales pour lutter contre les pucerons ont fait mourir des milliers de ruches, notamment en 1975, et c’est resté dans la mémoire collective. Mais en Champagne, où je travaille, on n’a jamais rapporté de cas de mortalité d’abeilles causés par les néonicotinoïdes, pas plus qu’ailleurs en France. Le programme OMAA du ministère de l’Agriculture en atteste. L’expérience Agrapi menée à Tilloy-et-Bellay dans la Marne (un rucher installé en zone céréalière et betteravière) a, au contraire, permis en 2018 de récolter jusqu’à 158 kilos de miel par ruche – dans un milieu considéré pourtant comme impropre à la survie des abeilles en raison de la présence de résidus de néonicotinoïdes –, quand la moyenne française tourne autour de 20 kilos.
Des études scientifiques tendent pourtant à montrer un lien de causalité entre néonicotinoïdes et mortalité ou problème de comportement des abeilles.
Les laboratoires travaillent sur des populations de 50 abeilles. C’est ignorer complètement la capacité de résilience d’une ruche, composée de 20 000 à 80 000 individus. L’Inrae a également compté le nombre d’abeilles retournant à la ruche après avoir été mises en contact avec des néonicotinoïdes. Sauf que les concentrations utilisées dans cette expérience étaient dix fois supérieures à celles que les abeilles rencontrent dans le milieu naturel. Si les pesticides jouent un rôle, c’est à la marge.
Alors, pourquoi le milieu apicole continue-t-il à dénoncer l’usage des néonicotinoïdes ?
Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d’abord l’inconscient collectif, qui associe les produits chimiques à la guerre (l’ypérite, le Zyklon B). Puis sont survenus deux accidents, dus à des défauts d’enrobage, en 2002 à Saint-Gaudens et deux ans plus tard en Allemagne, qui ont entraîné la mort de plusieurs milliers de ruches. Ils ont contribué à fonder le mythe actuel qui veut que les insecticides systémiques soient le diable. Les pesticides sont devenus le bouc émissaire idéal, l’ennemi commun servant à cimenter une profession divisée (on compte sept syndicats différents pour 4 000 apiculteurs !), dont les membres se livrent une concurrence acharnée sur les lieux de production et les lieux de vente. On a glissé de la lutte contre les parasites à la lutte contre les pesticides qui tuent les parasites. C’est fou ! Je qualifie cela d’hystérie collective…
Quelles seraient alors les causes de la surmortalité des abeilles ?
Outre la négligence de certains apiculteurs, qui ne savent pas travailler leurs ruches, l’une des causes principales est le parasitisme. Je citerais le varroa, un acarien apparu en 1982, et le Nosema Ceranae, découvert en France en 2005, quand des négociants en miel ont commencé à importer massivement miel et gelée royale de Chine. Ces deux parasites ont fait exploser le virus de la maladie noire et provoqué l’effondrement des défenses immunitaires des abeilles. Or, celles-ci ont été d’autant plus fragilisées que leur milieu s’est appauvri. Nos abeilles vivent dans la logique de l’oasis et du désert. Des oasis de très forte production au moment où fleurissent le colza, la luzerne, le tournesol et la lavande. Et entre deux oasis, des phases de désert absolu. Les lisières forestières, qui sont le milieu le plus riche de la forêt, ont disparu. C’est l’une des conséquences de la réforme de la PAC de 1992, qui a imposé aux agriculteurs d’entretenir les espaces au moyen d’épareuses. En cela, ils ont été la main aveugle d’une décision prise au-dessus d’eux. Le problème de la disparition de la ressource florale – et donc de la nourriture – est l’une des principales causes de la crise apicole qui a émergé dans les années 2000. Mais c’est aussi le problème le plus facile à résoudre.
Les agriculteurs détiennent-ils une partie de la solution ?
Oui, en plantant des jachères apicoles et en laissant des bandes non fauchées sur leurs parcelles. Une expérience menée dans la montagne de Reims dès 2004 montre que la création d’une zone de compensation écologique sur 0,3 % à 0,5 % de la surface apporte entre 66 % et 85 % du pollen nécessaire aux abeilles durant la floraison, qui peut durer un mois et demi. Il ne faut donc pas grand-chose pour améliorer la situation ! Mais cela a un coût. C’est pourquoi le Réseau Biodiversité pour les Abeilles que je préside a lancé l’opération Coup d’Pousse afin de collecter des dons servant à financer l’implantation de couverts mellifères.
On parle beaucoup de l’abeille domestique, mais beaucoup moins des abeilles sauvages.
Effectivement, les populations d’abeilles domestiques ne sont pas en danger. Le nombre de ruches a même augmenté de 20 % en Champagne-Ardenne depuis dix ans avec l’augmentation du prix du miel. Le problème s’observe plutôt chez les abeilles sauvages, menacées par la disparition de leur habitat. On détruit leur maison quand on laboure un champ de céréales. C’est la raison pour laquelle les populations d’abeilles sont bien plus importantes dans les vignes, où l’on a conservé chemins et fossés, que dans les champs, quoique la fréquence des traitements aux pesticides y soit beaucoup plus importante qu’en milieu céréalier…